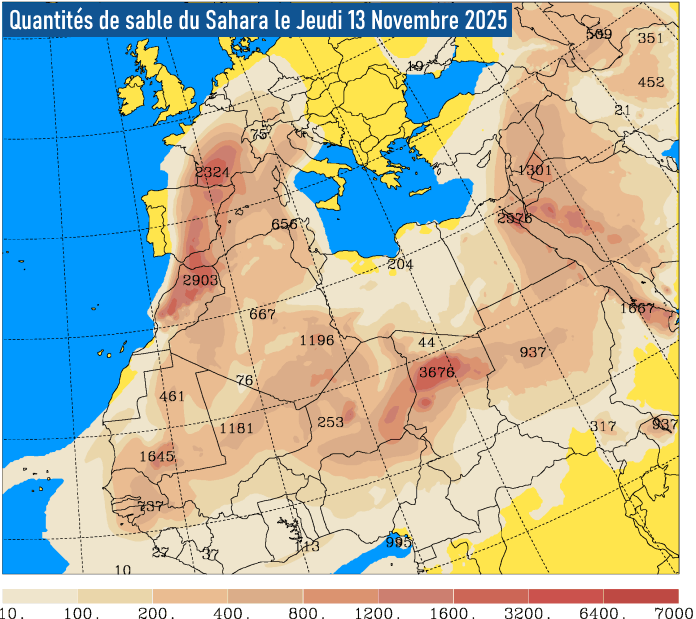La banquise Antarctique a atteint son troisième plus bas niveau
En 2025, la banquise d’hiver de l’Antarctique a enregistré sa troisième extension la plus faible depuis le début des mesures satellitaires, illustrant une tendance préoccupante. Depuis près de cinquante ans, ces observations permettent de suivre précisément l’évolution de la glace de mer autour du pôle Sud. La diminution rapide de la banquise, alimentée par le changement climatique, révèle l’importance de la surveillance scientifique et soulève de nouveaux enjeux pour la stabilité du climat mondial.

Évolution historique de la banquise antarctique : des records à la fonte
Depuis l’introduction des observations par satellite il y a près d’un demi-siècle, la surface de la banquise d’hiver – la glace de mer formée chaque année autour de l’Antarctique – a varié, avec une légère hausse irrégulière relevée jusqu’en 2016. Depuis, un changement marqué s’est produit : la surface gelée diminue plus rapidement, atteignant en 2025 un maximum de 17,81 millions de kilomètres carrés le 17 septembre, selon les dernières données du National Snow and Ice Data Center (NSIDC).
Les deux années précédentes avaient déjà marqué les esprits : 2023 reste l’année du record absolu de faible extension (16,96 millions de km²), et 2024 le deuxième plus bas niveau. Cette évolution ne se limite pas à un simple cycle naturel : elle coïncide avec un réchauffement inédit des eaux océaniques qui bordent le continent antarctique.
L’accélération de la fonte de la banquise antarctique souligne la transformation rapide des pôles sous l’effet du changement climatique.
Pourquoi la fonte de la banquise s’accélère-t-elle autour de l’Antarctique ?
La banquise est une couche de glace formée par le gel de l’eau de mer, qui s’étend chaque hiver sur des centaines de kilomètres au large du continent. Jusqu’à récemment, elle jouait un rôle de « barrière froide » contre la chaleur océanique. Désormais, la hausse des températures de l’océan permet à l’eau plus chaude d’atteindre directement les zones proches de l’Antarctique, limitant la formation de nouvelle glace et accélérant la fonte en fin de saison froide.
Cette modification du cycle annuel, où la banquise atteignait traditionnellement son extension maximale entre septembre et octobre avant de reculer avec le retour du soleil austral, s’observe désormais avec des surfaces de glace nettement plus faibles au pic de l’hiver.
Conséquences de la fonte de la banquise sur le climat et la biodiversité
La disparition progressive de la banquise n’engendre pas directement une montée du niveau des mers, car il s’agit de glace flottante. Mais les impacts sur le climat mondial sont majeurs. En remplaçant une surface blanche – qui réfléchit la lumière du soleil (phénomène appelé albédo) – par une mer sombre absorbant l’énergie solaire, la fonte de la banquise accentue le réchauffement local. Ce processus, appelé réchauffement local, accélère la fonte de la glace environnante et perturbe l’équilibre thermique régional.
La banquise constitue aussi une protection pour la calotte glaciaire – la masse de glace posée sur le continent antarctique. Sans ce « rempart », la calotte, fragilisée, peut s’écouler plus facilement vers l’océan, contribuant alors à l’élévation globale du niveau de la mer. À long terme, la réduction persistante de la banquise pourrait ainsi amplifier la montée des eaux et modifier les habitats de nombreuses espèces polaires, menaçant la biodiversité locale.
Un effet inattendu est également envisagé par les chercheurs : la fonte pourrait favoriser un air plus humide et donc accroître les chutes de neige près des côtes. Cependant, cette augmentation de la neige ne compense pas la perte globale de masse glaciaire observée sur le continent.