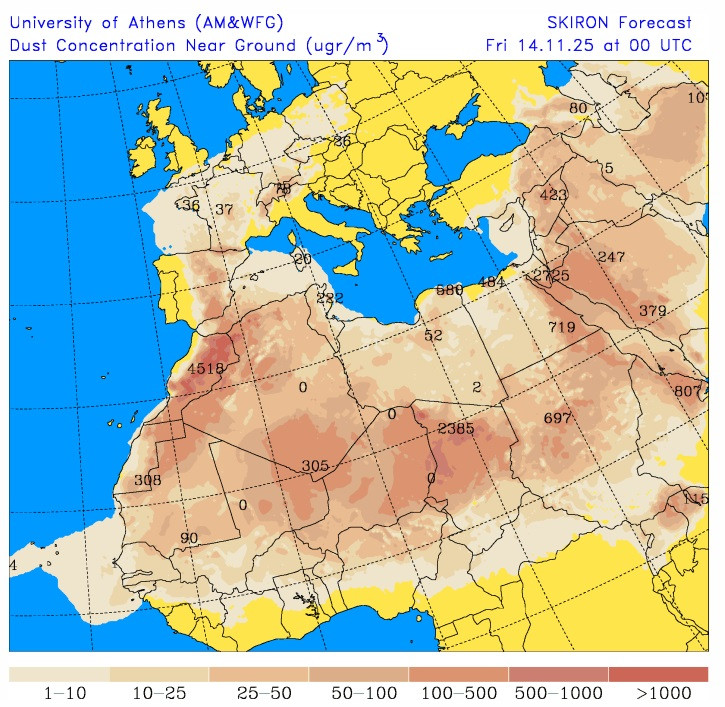Dépollution de l'eau du robinet : les consommateurs paient, ça suffit !
La qualité de l’eau potable se dégrade en France, tandis que la surveillance s’intensifie. Résultat : davantage de contaminants détectés et des traitements plus lourds, donc plus coûteux. Les usagers voient déjà leur facture progresser, alors que les collectivités doivent investir dans des technologies avancées. L'UFC-Que Choisir appelle à faire appliquer le principe du pollueur-payeur.

Qualité de l'eau en recul : ce que montrent les analyses
La part des réseaux respectant l’ensemble des critères réglementaires est tombée à 85 %, soit −10 points par rapport à 2021. La baisse s’explique surtout par l’élargissement des contrôles depuis 2023, qui met au jour de nouvelles molécules liées à la pollution.
Les dépassements ne se limitent plus aux petites communes. Des villes comme Reims, Beauvais, Caen, La Rochelle ou Calais sont désormais concernées. Les régions des Hauts-de-France, du Grand Est et d’Île-de-France apparaissent particulièrement exposées.
Seuils réglementaires : comment lire une non‑conformité ?
Depuis 2023, les analyses intègrent de nouveaux résidus de pesticides, leurs métabolites (produits de dégradation), les PFAS (composés per‑ et polyfluoroalkylés), mais aussi des familles déjà suivies comme les nitrates.
Pour les pesticides, le seuil est de 0,1 µg/L par substance et 0,5 µg/L pour l’ensemble. Un dépassement conduit à classer l’eau en « non conforme » et à déclencher des actions correctives par le gestionnaire. Ces seuils traduisent un principe de précaution ; la grande majorité des habitants reçoivent une eau potable sûre.
Définitions utiles :
- PFAS : polluants dits « éternels », très persistants, utilisés dans de nombreux procédés et produits industriels.
- Métabolites de pesticides : molécules issues de la transformation des pesticides initiaux, parfois plus mobiles et détectables.
Pourquoi la facture augmente-t-elle ?
Les traitements se renforcent et se complexifient. On augmente les doses de charbon actif pour capter les résidus de pesticides, tout en ajoutant des barrières successives, comme l’a fait une régie qui a mis en place deux étapes de traitement.
Note : Le charbon actif est un matériau très poreux qui adsorbe des molécules. Il reste toutefois peu efficace face à de nouveaux métabolites et à de nombreux PFAS. Les opérateurs se tournent alors vers la filtration membranaire, une barrière physique très fine, performante mais coûteuse.
Au niveau national, la dépollution dépasse désormais 1 milliard d’euros/an. Une régie locale cite une facture passée d’environ 300 000 € à près de 1 million d’euros en dix ans.
Pour aller plus loin, des besoins supplémentaires jusqu’à 13 milliards d’euros/an sont avancés pour la politique de l’eau, dont 5 milliards pour les coûts environnementaux. Les grandes structures (ex. syndicat francilien) amortissent mieux ces investissements grâce aux économies d’échelle, ce qui est plus difficile pour de petites communes.
Après une décennie stable, le prix du mètre cube a grimpé d’environ 16 % en 30 mois. La hausse traduit l’effort de mise en conformité et l’intégration de nouvelles étapes de traitement.
Qui pollue, qui paie ?
Les analyses de flux pointent que près de 75 % des nitrates et environ 70 % des pesticides proviennent du secteur agricole. L’industrie est identifiée pour les PFAS. Aujourd’hui, la dépollution est majoritairement réglée par les consommateurs via leur facture.
Une campagne nationale – « La goutte de trop » – lancée le mardi 18 novembre met en avant l’application effective du pollueur‑payeur : faire contribuer les secteurs à l’origine des contaminations, prévenir en amont et protéger les captages.
S’informer : cartes, analyses et prochaines étapes
Des outils publics permettent de visualiser l’exposition de chaque commune à cinq grandes familles de polluants (pesticides et métabolites, PFAS, nitrates, chlorure de vinyle monomère, perchlorates) et d’accéder aux derniers résultats d’analyses.
La recherche de certains PFAS deviendra systématique au 1er janvier 2026, ce qui élargira encore le spectre de surveillance. Dans la pratique, cela peut faire remonter de nouvelles non‑conformités et imposer des traitements plus techniques.
À noter : la grande majorité des habitants reçoivent une eau potable sûre, mais cette potabilité s’obtient au prix d’une dépollution croissante.