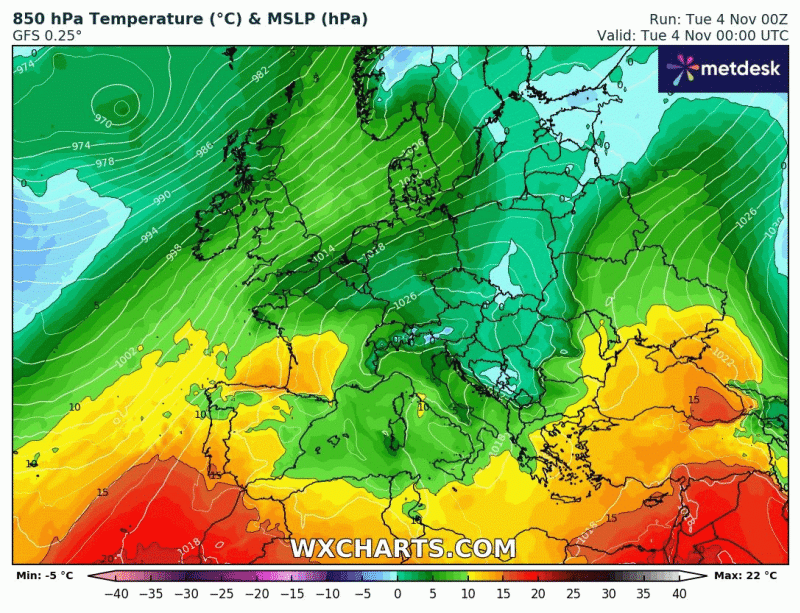L'activité du soleil repart à la hausse et inquiète la NASA
Après une longue période de calme solaire, la communauté scientifique observe un réveil inattendu de notre étoile. Les dernières analyses de la NASA révèlent une intensification de l'activité solaire, remettant en cause les prévisions et exposant nos infrastructures à de nouveaux risques.

Un réveil solaire inattendu après vingt ans de calme
Depuis la fin des années 1990, différents satellites – notamment ACE (Advanced Composition Explorer) et Wind – suivent en continu l’activité du Soleil. Jusqu’en 2008, tout semblait indiquer que notre étoile entrait dans une phase de calme durable, semblable au minimum de Maunder (1645-1715), période historiquement marquée par une forte baisse de l’activité solaire.
À cette époque, les mesures montraient un affaiblissement inédit du vent solaire, de la densité du plasma et du champ magnétique interplanétaire.
Mais, contre toute attente, les données collectées depuis 2008 tracent une courbe ascendante. Le vent solaire a vu sa vitesse progresser de 6 %, sa densité de 26 % et sa température de 29 %. L’intensité du champ magnétique interplanétaire grimpe de 31 % selon l’équipe du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, dirigée par Jamie Jasinski.
Ce basculement contredit les modèles établis et laisse présager une période d’intense activité solaire pour les décennies à venir. Les observateurs constatent déjà la multiplication des taches solaires, des éruptions et des éjections de masse coronale.
Des cycles solaires plus complexes qu’anticipé
Le Soleil suit un cycle d’activité moyen de 11 ans – le cycle de Schwabe – caractérisé par une alternance de phases actives et calmes. Parfois, ces cycles s’inscrivent dans des variations encore plus longues, comme le cycle de Hale (22 ans) ou le cycle de Gleissberg, qui pourrait durer environ un siècle. Malgré des décennies d’observations, la dynamique exacte et la succession de ces cycles restent mal expliquées.
Historiquement, des périodes prolongées de faible activité – outre le minimum de Maunder, le minimum de Dalton (1790-1830) – ont été identifiées. Pourtant, les chercheurs avouent que les causes de ces longs cycles et leurs enchaînements échappent largement à la compréhension actuelle.
D’après Jamie Jasinski, les tendances à long terme sont difficiles à anticiper. Ainsi, la récente hausse d’activité pourrait marquer la fin d’un épisode atypique, sans signifier pour autant le retour à une norme stable. La prévision des extrêmes solaires reste donc un défi scientifique majeur.
Des conséquences tangibles sur nos technologies et nos sociétés
L’intensification de l’activité solaire n’est pas sans conséquences. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale (CME) libèrent des particules énergétiques qui, en atteignant la Terre, provoquent des tempêtes géomagnétiques. Ces phénomènes perturbent les réseaux électriques, endommagent les satellites et désorientent les systèmes GPS.
L’épisode de mai 2024 illustre cette menace : une tempête géomagnétique classée « extrême » a généré des aurores boréales inhabituelles jusqu’aux latitudes moyennes et causé des dommages évalués à plus de 500 millions de dollars sur les infrastructures. Les satellites, exposés à ces particules, peuvent voir leur électronique défaillir, subir des variations d’orbite ou perdre tout contact. En février 2022, une tempête avait ainsi entraîné la perte de 40 satellites Starlink fraîchement lancés.
Face à ces risques, la NASA et la NOAA développent de nouvelles missions de veille solaire, comme la sonde IMAP et le satellite SWFO-L1, afin d’améliorer la prévision du climat spatial et d’anticiper les impacts sur les technologies critiques.