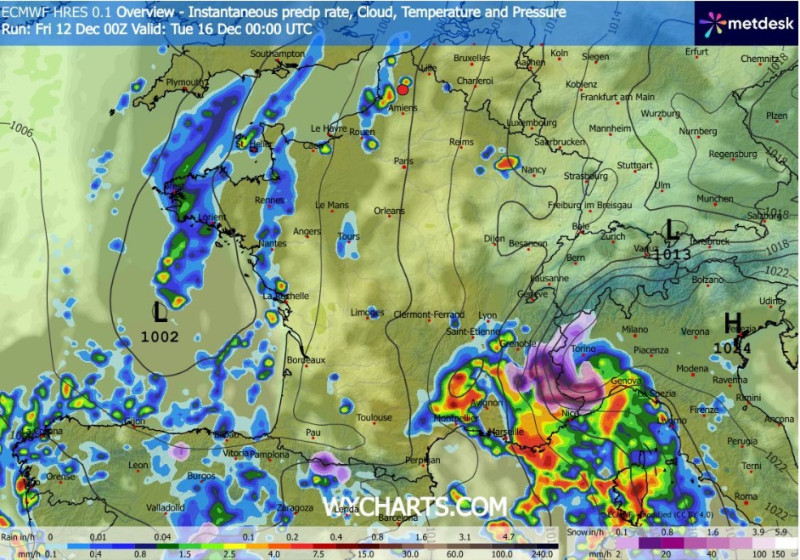La lenteur exceptionnelle de l'ouragan Mélissa inquiète la Jamaïque, voici pourquoi
L’ouragan Melissa, un phénomène de catégorie 5 d’une violence inédite, menace directement la Jamaïque ce mardi 28 octobre. Sa particularité ? Une progression anormalement lente qui exacerbe les risques de destructions massives, d’inondations et de drames humains.

Un ouragan d’une intensité record, alimenté par des eaux exceptionnellement chaudes
Melissa s’est formé au-dessus de la mer des Caraïbes, où la température de l’eau a atteint des niveaux anormalement élevés. Cette chaleur constitue le carburant principal de l’ouragan, lui permettant d’atteindre rapidement la catégorie 5 — le maximum sur l’échelle de Saffir-Simpson, utilisée pour classer les ouragans selon la force de leurs vents.
La structure de Melissa impressionne les météorologues : œil symétrique, organisation parfaite, pression centrale tombée à 901 hPa (rarement observé dans l’Atlantique), et des vents moyens de 280 km/h, avec des rafales mesurées jusqu’à 388 km/h — un record historique pour le bassin Atlantique.
La formation rapide et la puissance de Melissa s’expliquent aussi par l’absence de cisaillement du vent (différences de direction et de vitesse dans l’atmosphère), ce qui permet à l’ouragan de s’organiser sans entrave. Mais c’est surtout sa lenteur extrême qui inquiète.
Pourquoi la lenteur de Melissa amplifie-t-elle les risques ?
Un ouragan qui ralentit ou stagne au-dessus d’une zone peuplée, c’est le scénario redouté par tous les experts. Habituellement, un ouragan se déplace à une vitesse comprise entre 15 et 30 km/h.
Melissa, lui, avance à seulement 4 km/h environ — à peine la vitesse d’un marcheur. Que se passe-t-il alors ?
- Les zones touchées restent exposées aux vents destructeurs (200 à 250 km/h) pendant plus de 8 heures d’affilée.
- Des précipitations diluviennes s’accumulent : jusqu’à 750 mm de pluie sur trois jours, soit l’équivalent d’une année de pluie à Paris, pouvant dépasser 1 000 litres d’eau par mètre carré localement.
- L’élévation du niveau de la mer attendue atteint 4 à 5 mètres, accompagnée de vagues massives.
Le résultat ? Des inondations majeures, notamment dans les plaines littorales et les vallées, une saturation rapide des sols déjà fragilisés, et un risque accru de glissements de terrain. Les habitations légères, fréquentes sur l’île, sont les premières menacées par la force des vents et la montée des eaux.
Impact humain et vulnérabilités locales : une situation d’urgence
La Jamaïque a déjà payé un lourd tribut avant même le passage direct de l’ouragan : trois morts lors des préparatifs, auxquels s’ajoutent quatre décès recensés en Haïti et en République dominicaine. Les populations vivant dans des habitations précaires, en particulier dans des zones comme Black River, sont les plus exposées à la catastrophe.
Les infrastructures locales, souvent peu adaptées à une telle violence, risquent de subir des dommages majeurs. Routes, réseaux électriques, écoles et hôpitaux pourraient être durement touchés, compliquant l’accès aux secours et la prise en charge des blessés. La capitale Kingston, située à l’est, devrait toutefois être moins affectée par les vents les plus violents, concentrés sur l’ouest et le sud de l’île.
Phénomènes de tempêtes stagnantes : une tendance inquiétante dans les Caraïbes
On observe, ces dernières années, une augmentation apparente des tempêtes stagnantes dans la région caraïbe, surtout en octobre.
Pourquoi ce phénomène est-il si préoccupant ? Plus un ouragan reste longtemps sur une zone, plus il amplifie les dégâts : les sols n’ont pas le temps d’absorber l’eau, les infrastructures s’effondrent sous la pression, et l’aide d’urgence devient plus compliquée à organiser.
La Jamaïque, déjà fragilisée par des pluies récentes, affronte donc un risque maximal.
FAQ : vos questions sur l’ouragan Melissa
Pourquoi Melissa est-il si lent ?
Son déplacement est freiné par des conditions atmosphériques particulières (vents faibles en altitude, absence de courant directeur), favorisées par le réchauffement des eaux. Cela ralentit sa progression et accroît sa dangerosité.
Quelles régions de la Jamaïque sont les plus exposées ?
La moitié ouest, notamment le littoral sud-ouest (région de Black River), subira les vents et pluies les plus intenses. Les zones montagneuses sont aussi menacées par des glissements de terrain.
Peut-on relier ce type d’ouragan au changement climatique ?
De nombreux spécialistes suspectent un lien entre la fréquence des tempêtes stagnantes et le réchauffement climatique, mais des recherches complémentaires sont nécessaires pour le prouver formellement.
Comment les habitants peuvent-ils se préparer ?
Suivre les consignes des autorités, renforcer les habitations, s’éloigner des côtes, constituer des stocks de survie et rester à l’écoute des bulletins météo sont des réflexes à adopter en urgence.