Chaleur extrême : notre corps la supporterait moins bien qu'on le pensait selon une étude
De nouvelles recherches montrent que la capacité du corps humain à supporter la chaleur est plus limitée que ce que l’on pensait. Face à la multiplication des épisodes de chaleur intense, il devient crucial de mieux comprendre nos seuils d’adaptation.
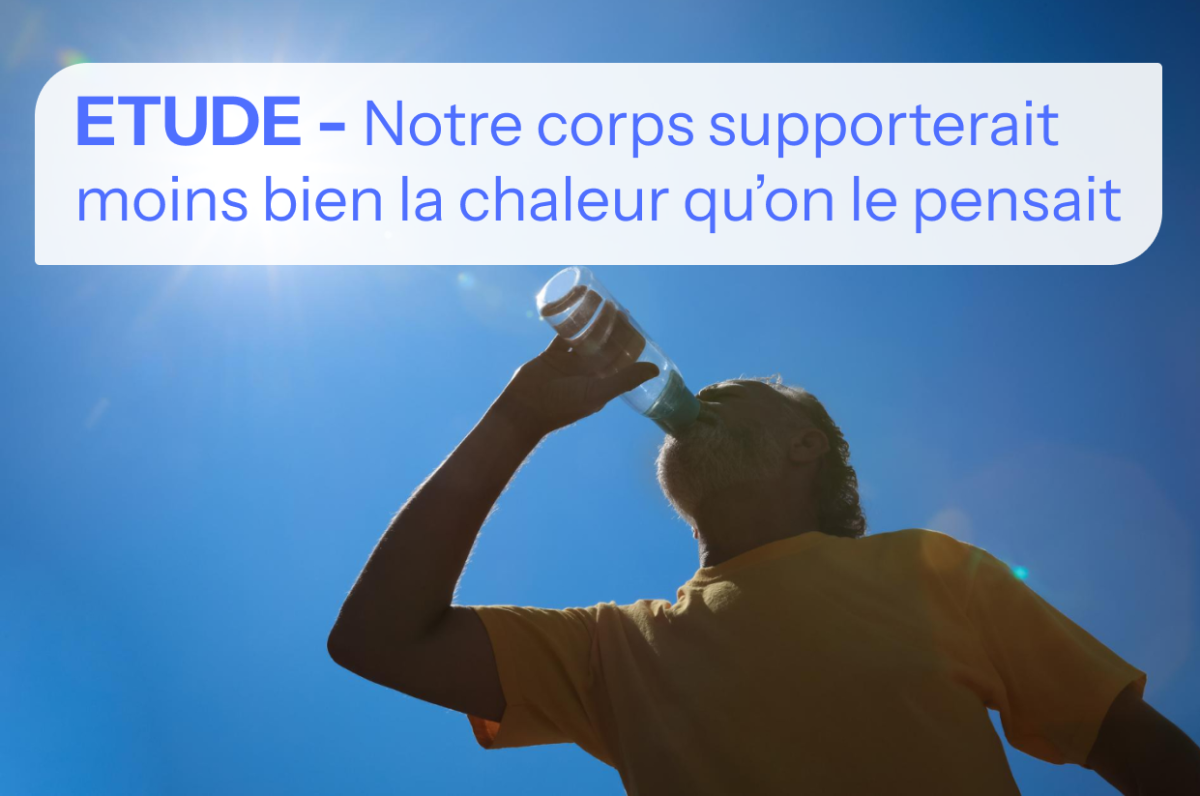
La thermorégulation humaine : des limites plus basses que prévu
La thermorégulation désigne la capacité du corps à maintenir une température interne stable, même lorsqu’il fait très chaud. Jusqu’à présent, on pensait que l’être humain pouvait supporter des conditions extrêmes allant jusqu’à 35 °C au thermomètre humide. Ce seuil correspond à 35 °C sous une humidité de 100 % ou à 46 °C avec 50 % d’humidité.
Cependant, une récente étude menée par l’équipe de Robert Meade et Glen Kenny, à l’Université d’Ottawa, indique que la résistance humaine serait en réalité plus faible. Leurs travaux montrent que la limite critique se situerait plutôt entre 26 °C et 31 °C au thermomètre humide.
Des records de chaleur de plus en plus fréquents
Or, ces limites sont désormais très régulièrement dépassées dans le monde.
La planète connaît déjà des températures extrêmes dépassant le seuil des 50 °C, relevées en 2024 aux États-Unis, au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Inde ou en Chine. D’autres pays, comme le Mexique, la Jordanie, l’Irak ou le Pakistan, ont également connu des pics comparables.
Au Canada, si les 50 °C n’ont pas été franchis, la tendance à la hausse est nette. On se souvient de la vague de chaleur exceptionnelle de juin 2021 à Lytton, près de Vancouver, où le thermomètre a grimpé à 49,5 °C, causant la mort de dizaines de personnes.
Le rôle de l’humidité : quand la transpiration ne suffit plus
Pour se refroidir, le corps humain mise sur la transpiration. Mais lorsque l’humidité est maximale, ce mécanisme devient inefficace. C’est pourquoi les spécialistes s’appuient sur le thermomètre humide, un outil qui associe température et humidité pour mesurer la capacité d’adaptation du corps.
Les chercheurs ont exposé des volontaires à des températures allant jusqu’à 42 °C avec 57 % d’humidité (l’équivalent d’un humidex de 62) pendant neuf heures. Résultat : la température corporelle des participants augmentait sans cesse, empêchant nombre d’entre eux de terminer l’épreuve.
"C’est important de maintenir un système stable parce que toute notre physiologie est basée sur le contrôle de la température", détaille le professeur Glen Kenny. "Imaginez une voiture sans système de refroidissement! Le moteur va surchauffer très rapidement !" ajoute-t-il.
Des seuils variables selon les individus et les saisons
La tolérance à la chaleur n’est pas la même pour tous et peut varier selon la saison. Par exemple, lors d’une première canicule en mai, la capacité d’adaptation est généralement plus basse que lors d’un épisode similaire en septembre.
Certaines personnes, notamment les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques, sont particulièrement vulnérables. Ces différences doivent être prises en compte pour adapter les politiques de santé publique et les mesures de prévention.
Vers une meilleure prise en compte des risques sanitaires
Les chercheurs insistent sur la nécessité de disposer d’outils précis pour évaluer le risque de stress thermique.
"En intégrant les données physiologiques aux modèles climatiques, nous espérons mieux prédire les problèmes de santé dus à la chaleur, ce qui nous permettra de mieux intervenir auprès des plus vulnérables", explique Glen Kenny.
Ces avancées devraient orienter les actions des autorités et guider la mise en place de mesures adaptées pour protéger la population face à la multiplication des vagues de chaleur.
Sources : publication de l'étude (anglais), article radio Canada



















